Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Russie, Géorgie Arménie, Iran, du 11 Septembre au 5 Décembre 2023
Des parterres de fleurs multicolores défilent devant mes yeux, dans un ballet hypnotique quand soudain, la tenancière du restaurant éteint la télévision. Elle m’explique que ce sont les parterres de fleurs chéries par le président Imomali Rakhmon, qui sont plantées devant les bâtiments officiels de la ville de Khorog pour fêter l’indépendance du Tadjikistan. Khorog est la capitale de la région autonome du Haut-Badakhchan. Je suis venu jusqu’ici pour visiter son jardin botanique qui abrite quelques Malus sieversii, l’espèce de pommier sauvage dont descendent directement nos pommiers domestiques. 1 Les habitant·e·s voisin·e·s viennent librement ramasser les pommes succulentes du jardin.
Une vue sur la vallée est barrée par l’immense résidence secondaire du président. Quelques étiquettes, des ruines de tunnels horticoles et un jardin de micro-parcelles témoignent des collections de plantes rares jadis cultivées. Aujourd’hui, le jardin est largement abandonné, excepté aux abords de la résidence présidentielle.

Tunnels horticoles du jardin botanique de Khorog
Deux jours plus tard, je m’élance à l’ascension des montagnes du Pamir, toujours sur la route Murghab. Après Khorog, les premiers kilomètres de la route construite par l’URSS sont souvent couverts pour la protéger des éboulis fréquents. Les grandes fresques à la gloire de la puissance des travailleurs et travailleuses de tout pays sont vivifiantes. Cette esthétique rappelle une époque où ces républiques soviétiques portaient encore, pour une partie du monde, l’espoir d’un modèle alternatif au capitalisme. Certaines des personnes que j’ai rencontré et qui ont vécu sous l’URSS me parlent avec nostalgie de cette époque. Ils avaient bien plus d’opportunité de travail, la région frontalière avec l’Afghanistan était stratégique et les salaires bien plus élevés qu’ailleurs en URSS. Un ancien général de l’armée me parle avec fierté de sa participation à l’invasion de l’Afghanistan en 1979…
Progressivement, Moute ma bicyclette monte sur la longue pente douce. La vallée du Gunt s’ouvre et laisse de la place aux humains pour cultiver le fourrage de leur bétail. La fraîcheur automnale est descendue sur ce bout de vallée, autour des 2600 mètres d’altitude. Les arbres
qui digèrent leur chlorophylle laissent apparaître des teintes plus chaudes, signal aux humains qu’il est temps d’engranger les herbes mûres. Les faucheu·rs·euses qui s’activent de toutes parts attisent ma curiosité. Une invitation à boire le thé me donne l’occasion de lier connaissance avec eux et elles. Ils et elles acceptent que je les aide quelques jours pour mettre le foin fraîchement fauché en gerbe.
Retrouvez les faucheu·rs·euses qui me parlent dans leurs prairies entourées de buisson, dans cet article : Les gens Dehmiyona fauchent leur foin.
Le vif froid du matin, me rappelle de me dépêcher de partir explorer les plus hautes altitudes, avant qu’il ne les congèle complètement. Nous repartons donc, décidé à nous élever bien au-dessus de ces jardins habités, vers les montagnes désertées. Assez rapidement, les arbres disparaissent complètement au profit d’une végétation ramassée et brunie par le froid, qui est installée à partir de 3000 m d’altitude. Ici, ce ne sont plus seulement mes yeux qui voient les effets de l’altitude dans le paysage, mais ma peau qui se sent sèche, mes poumons qui cherchent de l’air. En septembre, les fleurs ont quasiment toutes disparues. Les photos que vous voyez sont celles des ultimes fleurs de la saison immédiatement photographiées.




De rares vaches pâturent une herbe tout aussi rare, l’essentiel de la végétation est formé par une lande d’Armériacées épineuses du Genre Acantholimon. Le cours d’une rivière que je remonte irrigue toute une série de végétations sénescentes. Après les rapides, le cours du petit torrent se calme plus haut, il s’étend même et permet à un petit paysage bryophytique de mousses végétales, de se développer malgré l’aridité environnante. Des feuilles de renoncule aquatique subsistent dans quelques petites mares. Seulement un mètre au-dessus du torrent, la terre aride restreint le développement de quelques renouées, rumex, euphraises et edelweiss.
Le sommet de la balade donne vue sur les pics Karl Marx et Engels complètement recouverts de glace, qui dépassent
d’impressionnantes montagnes. Le paysage semble absolument minéral, jusqu’à ce que m’allongeant au sol, épuisé par le manque d’oxygène, de minuscules plantes se révèlent. Elles ressemblent à de minuscules Paroniche compactes.
Une balade à pied qui remonte une rivière sulfureuse, qui parfume l’air rare m’emmène vers des montagnes désertiques baignées par le rayonnement cru du soleil. Cet environnement inconfortable donne la sensation de marcher sur une autre planète.
Le silence parfait du plateau du Pamir, largement épargné de l’activité frénétique des humains, est parfois brisé par des hurlements plaintifs et saccadés de monstres. Ce sont les moteurs des
camions soviétiques, les Kamaz qui ont du mal à brûler leur essence par manque d’oxygène, contrairement à mon organisme qui s’adapte progressivement. Ils traînent péniblement leurs fardeaux de double remorques de tôle qui, ébranlée par la route défoncée, lancent des coups de
tonnerres à la ronde. Plus silencieux, un autre cyclo campeur arrive à ma haute. En franchissant le seuil que forme le col du koj-tezek, nous entrons de plain-pied sur ces hautes terres tant fantasmées ces dernières années. Le brun luisant des herbes sénescentes qui couvrent le fond
d’une vallée, est aussi profond que le bleu du ciel cyan. Les crêtes des massifs montagneux sculptent l’horizon. Quelques larges vallées plates bordées de sommets, nous procurent des vertiges horizontaux. La moindre petite mare, si rare soit elle, saisit la vue par la profondeur de sa
couleur. Les monts qui atteignent de 5000 à 6000 m ne sont finalement pas si impressionnants, seules leurs têtes émerges sur ces hauteurs. À l’approche de l’unique village nous apercevons un troupeau de vaches. De plus près, nous nous apercevons que ce sont en fait des Yaks qui broutent paisiblement. La
peau tannée et les yeux bridés, les villageois·e·s qui nous accueillent se démarquent des habitant·e·s des vallées par leur physionomie, mais ils sont également accueillant·e·s. Murghab est la seule ville de ces hautes terres désertiques. J’y rencontre des dizaines de cyclos voyageurs·es français·e·s, Allemand·e·s et Malaisien·ne·s, venu·e·s parcourir des altitudes extrêmes plus accessibles que le Tibet. La petite ville isolée ne possède pas d’hôpital et comme pour le reste du Haut-Badakhchan les réseaux routier et internet sont en grande partie inopérants, Cette région représente 40% de la superficie mais seulement 3% de la population du Tadjikistan, soit un peu plus de 230 000 habitant·e·s concentré·e·s dans quelques vallées. La prévenance des gents de Murghab, me permet de ressouder la fixation du porte-bagage cassée de Moute, et de dormir dans une yourte en métal.2
Je continue sur cette route désertique jusqu’à buter contre le plus haut col routier de mon voyage. Tout en haut de l’autre côté du col, le tableau composé de couleurs primitives rouges et blanches teintées de jaune créé une scène presque surnaturelle. Des petits glaciers bleutés survivent sur les faces nord des sommets balayés par les vents d’ouest salés.

À partir du col d’Akbajtal, la route se transforme en piste de gravier. Je ne retrouve vraiment l’asphalte qu’avant Dushanbe, soit 700 km de piste. À partir de ce point, je parcours tranquillement de 30 à 50 kms par jour maximum, sur une piste dépourvue de voiture. C’est quelque part le long de cette voie déserte, que je déjeune dans l’abri de piteuses ruines quand un
minibus s’arrête à ma hauteur. Les voyageurs y descendent lentement et avancent au milieu des restes de bâtiments, pour finalement s’agenouiller, ils et elles prient. Quel est l’objet de leurs
prières ? Quelle est l’histoire qu’ont abrité ces ruines reculées ? Je n’ose pas interroger ces étrangers.
Une journée de bicyclette plus tard, Rayan, un Néo-zélandais en migration à vélo vers l’Angleterre, croise ma route au bord du lac de Karakul, nous décidons de descendre la vallée de la rivière Barthang ensemble. Ce sera la partie la plus impressionnante et périlleuse de mon voyage en Asie centrale. Le premier jour, un violent vent de face et la surface de piste modelée en vague ou
« tôle ondulée » nous ralentissent, mais nous tenons bon. Nous traversons notre première rivière à guet, et trouvons par chance un abri contre le vent dans ce désert. Une structure métallique brise
étonnamment bien les rafales qu’une bâche finit de couper. Quelques kilomètres après cet abri de fortune, nous traversons une plaine réellement lunaire, seul le sol de rocailles grises qui reflète la lumière crue du soleil nous apparaît.

Chaque nuit, les petits torrents auprès desquels nous plantons nos tentes, se figent en surface dans une solide croûte de glace. Dans la matinée, le chant sourd de la glace qui cède sous l’effet de la chaleur du soleil, nous apaise et donne de l’espoir pour la journée à venir. Ces dégels quotidiens, comme une répétition du printemps, tardent cependant et nous sommes contraints de casser la glace pour collecter l’eau nécessaire à notre café. Au bout d’une vallée mignonnette, surgit une gigantesque barrière de sommets enneigés.

Nous nous éloignons des sommets enneigés pour mieux les retrouver. Nous rencontrons deux groupes de bergers isolés. La peau tannée et le sourire aux lèvres, ils sont un peu abîmés par le
métier. Un berger, s’est coupé un bout de doigt, un autre souffre de migraine. Ils acceptent volontiers les médicaments et épices que nous leur offrons, pour apaiser leurs maux. Resté au-dessus des 3800 m jusqu’à présent, nous quittons brutalement ces alpages par une piste en lacets serrés, qui descend dans le lit de la rivière Barthang, 500 m plus bas. Cette rivière est incroyable, son large lit anastomosé composé de multiples bras liquides, nous surprend par sa majesté.

Ce plongeon en dessous des 3300 m d’altitude change notre univers. À présent, le climat est plus doux et, chose incroyable, nous retrouvons des arbres. Le feuillage dense des arbres me procure une chaleur presque maternelle, j’étreins leurs troncs avec force. La variété des quelques végétaux vus en cette fin de septembre, est très comparable à celle observée trois semaines plus tôt au-dessus de Khorog.
Dernière un énième éboulement de blocs, nous découvrons en contrebas le village de Goudara. Tout un groupe d’enfants et quelques adultes entourent un troupeau de brebis. Le temps que nous descendions, chacun est reparti avec ses ovins. Le petit Chirine qui a 13 ans nous accueille dans sa maison d’hôte, et s’avère être un remarquable majordome. Il porte dignement sa veste grise « Lidl » qui lui donne une certaine prestance. A la fin du repas Chirine nous offre divers objets
informatiques tels que des cartes SIM, batterie, routeur… Il les a trouvé dans la rivière suite à la chute d’un 4×4 de touristes. Nous nous remémorons la voiture écrasée vue au début de la
journée avec une petite pensée pour ses occupants.
Quelques maisons en béton alignées dénotent au milieu de ce village traditionnel. Ce sont les bâtiments construits grâce à l’aide internationale suite au tremblement de terre de 2015,3 qui a détruit la totalité des maisons
traditionnelles en terre crue du village.4 Avant cette année-là, les habitant·e·s de Goudara n’avaient pas d’électricité, ils et elles s’éclairaient encore à la lampe à pétrole. Les villageois·e·s nous demandent des nouvelles de leurs amis bergers, que nous avons croisé la veille. Ces derniers commenceront bientôt la transhumance de retour au village. Nous laissons nos nouv·eaux·elles ami·e·s, qui finissent de battre le blé grâce au tracteur soviétique.

À partir de ce point, nous sentons chaque matin les effets de notre descente d’altitude. Les jours se réchauffent, la végétation prend de plus en plus de place et les villages grossissent progressivement. Pour l’instant, nous sommes encore éloignés de la vallée principale, celle du Piang qui forme la frontière avec l’Afghanistan. Nous devons littéralement gravir des montagnes
dans la vallée, un éboulement gigantesque barre cette dernière. Comment la rivière peut encore s’écouler? Elle ne s’écoule plus un peu plus haut, le lac Sarez considéré comme le plus dangereux du monde pourrait un jour inonder la vallée que nous descendons, si son barrage naturel venait à céder. Je retrouve avec plaisir les villages dans leurs écrins de rochers. Sous les 2500 m, nous rencontrons des vieux Abricotiers majestueux. Un des arbres en particulier nous frappe par sa grâce, il veillera sur nous pour une nuit.

Si les abricotiers semblent prospérer si bien ici, c’est que nos variétés domestiques sont originaires d’Asie centrale. Ce fruitier compose à l’attitude propice l’essentiel du couvert arboré des villages.5
Quand nous arrivons finalement dans la vallée du Piang, nous sommes frappés par l’effervescence de la ville de Rustavi. Un mois plus tôt, je ne la regardais pas ainsi, ayant même peine à croire qu’il s’agissait bien d’un village important. Rayan me quitte pour remonter vers des sources d’eau chaude. Pour ma part, je rebrousse le chemin à la rencontre de quelques-uns de mes amis, comme ceux du village de Voznawd qui m’ont tant donné. Pour retourner à Dushanbe, la capitale du Tadjikistan, j’emprunte la variante nord de la route du Pamir. Dès la sortie de la
région autonome du Haut-Badakhchan, le relief et le climat changent rapidement. La route monte le long d’une vallée abrupte qui se termine en canyon. La végétation me semble presque luxuriante après l’aridité du Pamir, des grandes plantes vivaces peuplent le bord des cours
d’eaux et de véritables forêts recouvrent certains pans de la montagne.
Bien que progressant toujours très lentement, je suis surpris par le contraste des différents paysages qui se succèdent. Après les montagnes vertigineuses, s’ouvre un panorama quasiment Provençal, les hautes collines rouges flamboyantes sont couvertes d’une végétation de garrigue hirsute. Enfin, à la sortie des montagnes, de grandes prairies, dignes des steppes mongoles, s’étendent vers l’est en direction du Kirghizistan. En même temps que je quitte les montagnes, je retrouve l’asphalte et les sensations de la vitesse prise en descente ! À peine cette joie retrouvée, la peine de se faire doubler par des hordes de voitures et camions me fait déjà regretter les pistes désertes du Pamir.
Heureusement, des portions de cette belle route sont bien cabossées, c’est à des endroits comme ceux-ci que des hommes en gilet orange équipés de leur pelle font leur retour. Leur rôle est de nettoyer la route des pierres qui tombent de la montagne, et de reboucher les trous avec la terre du bas-côté. La qualité de la rustine étant ce qu’elle est, ces cantonniers ne manquent jamais de travail et sont assez nombreux.

Une fois traversée Dushanbe, les montagnes de Fann se dressent à nouveau sur mon chemin. Ce relief est abrupt et abrite quelques beaux lacs, dont celui d’Iskanderkul.

Mes deux mois de visa sont bientôt écoulés, je repars dare dare sur la route pour passer la frontière.

De retour chez la famille qui m’avait accueilli au sud de Samarcand, le voisin Behzod professeur d’anglais, m’invite pour une journée dans l’école du village. Se succèdent heures après heures tous les niveaux. Au début de la journée les élèves arrivent au compte-goutte, certain·e·s devant parcourir plusieurs kilomètres à pied pour y arriver. Les cours de russe sont beaucoup plus animés, les enfants parlent déjà facilement cette langue. Un professeur d’une autre école me confirme que jusqu’en 2016, lui et ses collègues étaient réquisitionnés par l’état pour participer à l’effort de récolte du coton. Il devait ainsi travailler jusqu’à trois mois par an, dans les plantations de coton. Les cours étaient assurés pendant ce temps par quelques collègues resté·e·s en poste.
À partir de ce point, je rebrousse mon chemin jusqu’en Géorgie. Mon objectif est de rallier l’Inde à vélo sans avion. Depuis l’Asie centrale, trois pays sont frontaliers avec le Pakistan qui jouxte l’Inde : la Chine, l’Afghanistan et le Turkménistan via l’Iran. La Chine ne délivre pas de visa pour les Européen·ne·s en Asie centrale, l’Afghanistan est jugé trop dangereux et le Turkménistan trop cher. Je retourne ainsi vers l’ouest à la recherche des saisonnier·ère·s agricoles qui récoltent les derniers fruits du coton. Après deux jours à parcourir les plantations entre Samarcand et Bukhara, je dois me rendre à l’évidence : la récolte est terminée. Un Ouzbek, que je questionnais à ce sujet me demande mon pays d’origine, il s’exclame en toute logique « Ah FRANKISTAN! ».
Pour m’épargner un nouveau mois dans le désert, je saute dans un train. C’est un plaisir de dormir dans un wagon-couchette et de se réveiller au petit matin avec le
désert qui défile sous les yeux. Ce train relie Douchanbé au Tadjikistan à Volgograd en Russie, distant de 2800 kilomètres en 62 heures. Je m’arrête pour ma part à la frontière du Kazakhstan, au milieu du désert. Arrivé de nuit, je plante ma tente au milieu de nulle part. Cette nuit un brouillard givrant pétrifie ma tente, le désert est arrosé sous forme de glace en hiver. De l’autre côté de la frontière, je retrouve mon ami brésilien Louis, nous avions traversé une bonne partie de ce désert ensemble trois mois plus tôt. Je suis d’autant plus content de voyager à nouveau avec Louis que son long attelage, un vélo électrique qui tracte la remorque de son chien Beomero, attire l’attention des passants qui sont exclusivement des hommes. Fascinés par ce voyageur imposant, les Kazakhs puis les Russes m’ignorent, et c’est Louis qui doit répondre à leurs sempiternelles questions posées en russe : De quel pays viens-tu? D’où viens-tu? Où vas-tu? Combien de kilomètres as-tu parcouru ? Depuis combien de temps voyages-tu ? Es-tu marié ? As-tu des enfants ?
Pour les plus curieux, l’interrogatoire se poursuit par : Comment t’appelles-tu ? Quel âge as-tu ? Quel est ton métier ? Quelle est ta religion ? Dernièrement, une question s’est ajoutée à cette liste, elle est beaucoup plus rare, mais inquiétante : Es-tu juif ou israélien ?
Cette dernière question nous a été posée avant toutes les autres, en Tchétchénie par deuxgroupes d’adolescents boutonneux qui nous faisaient rire, mais qui étaient très sérieux. La veille, des manifestants anti-Israéliens envahissaient l’aéroport de Makhatchkala, capitale du Daghestan voisin. Pour écarter d’éventuelles questions hostiles pour la suite de mon voyage.
Nous passons le Caucase facilement, la neige n’accroche pas dans la vallée. La vue depuis le monument pour l’amitié Géorgie-Russie est toujours aussi somptueuse.

À Tbilissi, j’attends un ami devant des pancartes publicitaires à l’effigie des animateurs de la télévision géorgienne. Giorgie travaille ici comme peintre. Avec ses collègues, ils et elles fabriquent tous les décors de cinéma et de publicité possibles. Pendant la semaine que je passe en leur compagnie, ils et elles fabriquent un palmier multicolore pour un bijoutier, une tasse géante pour vendre du café… Cette tasse coûtera 3 500 € au client pour sept jours de travail à deux. Ils et elles utiliseront 5 m cubes de polystyrènes, de la résine polyester et de la peinture pour réaliser cet objet, qui ne sera visible que quelques secondes dans le spot publicitaire. Giorgie estime qu’il gagne correctement, ce qui ne lui permet tout de même pas de se payer un logement individuel. Il vit avec ses parents et grands-parents comme tout le monde.
Le passage en Arménie est visible partout dès la frontière, la longue influence russe est omniprésente. Des usines et immeubles d’un autre temps tombent lentement en ruines. Les ruines soviétiques sont par endroits aussi nombreuses, que les immeubles décrépis toujours occupés. Ces vestiges se fondent dans le plateau arménien rocailleux et gris en ce mois de novembre. Les bâtiments sont abandonnés peut-être. La démographie décline, un tiers des
habitant·e·s sont partis depuis l’ouverture des années 90.6
Si quelque chose ne tombe pas en ruine, c’est bien l’hospitalité des Arménien·en·s. Deux petites pichenettes sous la mâchoire, de l’index et du majeur réunis sont le signe que me donnent souvent mes interlocuteurs pour m’inviter à boire la vodka, à la santé des parents ! Le lac Sevan est un grand lac d’altitude, sa superficie équivaut à près de sept fois celle de la rade de Brest. La couleur bleu marine verdie par la lumière du soleil, ainsi que ses petites vagues nerveuses me rappelle ma baie natale. Le niveau du lac avait baissé de près de 20 m, suite à l’utilisation de son eau pour irriguer des cultures, au début du siècle passé. Une rivière a été détourné pour lui redonner son niveau d’origine. L’Arménie est un pays montagneux. Chaque jour, je me couche au fond d’une vallée, le matin, je grimpe la montagne suivante puis déjeune au sommet avant de la redescendre. La dernière vallée, la plus au sud de l’Arménie, à la frontière avec l’Iran se démarque par la luxuriance de ces jardins. Les vergers de plaqueminier de Meghri sont magnifiques, entourés de montagnes rouges aux crêtes acérées.
Le passage en Iran est un dépaysement radical. Après cinq mois passés au sein des républiques de l’ancienne Union soviétique, j’avais appris le russe presque naturellement sans toujours avoir cherché la définition des mots. En Iran, tout est différent, la langue, l’alphabet et l’ambiance générale. À dix kms de la frontière, je demande un endroit pour dormir, tout le monde m’indique la même direction qui me mène au fond de la vallée. Le bâtiment indiqué est gigantesque, près de 300 chambres entourent une mosquée. La mosquée brille de l’intérieur, ces murs et plafonds sont recouverts d’une mosaïque de miroir qui scintillent. J’apprendrai plus tard, qu’il s’agit d’un lieu saint très connu en Iran, les chambres hébergent les pèlerins qui arrivent par centaines pendant les fêtes religieuses.
L’Iran est un pays largement montagneux et je le ressens dès les premiers jours. A Tabriz les collines se parent de couleurs bigarrées. Éprouvé par le froid, je renonce à aller explorer la « jungle », comme l’appelle les Iraniens, du bord de la caspienne, car j’en suis séparé par la chaîne de montagnes de l’Elbourz. A Téhéran, les plus beaux bâtiments historiques sont perchés sur l’Elbourz. Des habitants me font visiter les palais de la dynastie des Pahlavi, renversés par la révolution qui a abouti à l’arrivée au pouvoir de la République Islamique actuelle.

Les jambes de Reza Shah sont les seules parties épargnées par la révolution islamique, qui a scié le corps de la statue en bronze. C’est un symbole fort pour les Iranien·en·s, qui parlent souvent de cet Iran impérial révolu.
Pour finir, voici la musique symbole de résistance face au régime Islamique à la fin 2023 :
Le marchand de poissons et animateur du club de Football local, Sadegh Bana Motejaded, 70 ans a été arrêté, après avoir posté la vidéo sur laquelle on le voit danser sur cette musique, et encourager les passant·es à faire de même. La vidéo totalise vite plus de 80 millions de vues, déclenchant la répression du régime et la résistance des Iranien·nes.
Carte interactive de ma route //umap.openstreetmap.fr/fr/map/bicyclette-en-herbe_914440?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&editMode=disabled&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false&captionMenus=true
Sources :
- https://novastan.org/fr/kirghizstan/comment-la-pomme-est-en-train-de-disparaitre-de-sa-terre- natale-lasie-centrale/ ↩︎
- https://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/tadjikistan-4Ht-Badakhchan.htm ↩︎
- https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMAnalyse/1246 ↩︎
- https://amp-agoravox-fr.cdn.ampproject.org/v/s/amp.agoravox.fr/culture- loisirs/culture/article/la-maison-traditionnelle-des- 239192?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=From%20% 251%24s&aoh=17015837698969&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=http s%3A%2F%2Fwww.agoravox.fr%2Fculture-loisirs%2Fculture%2Farticle%2Fla-maison- traditionnelle-des-239192 ↩︎
- https://www.inrae.fr/actualites/lhistoire-domestication-abricotiers-retracee-genomique ↩︎
- https://www.radiofrance.fr/recherche?term=Arm%C3%A9nie ↩︎
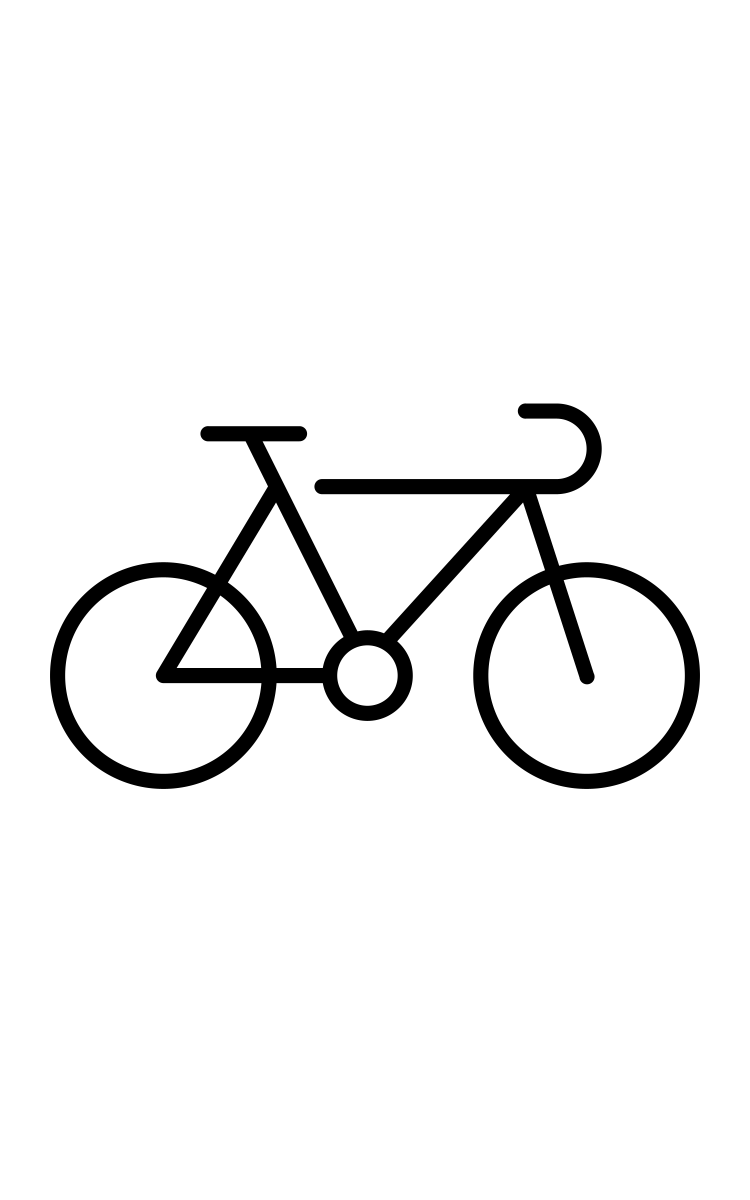

Laisser un commentaire