En Thaïlande et en Malaisie du 22 avril au 22 mai 2024
Une bande de chiens et chiennes, en provenance des maisons, que je viens de dépasser se lance à ma poursuite en lançant des aboiements enragés. Habitué à ces scènes, je fais mine de leur jeter des cailloux, pour les effrayer et stopper leur course. Alors que je pensais leur échapper, une côte me ralentit brutalement, la bande de clébards en profite pour m’encercler. Tandis que je gesticule et souffle pour maintenir à distance les pauvres bêtes, un homme dans mon dos me surprend en les invectivant violemment. Cet homme, qui roule en scooter électrique, s’appelle Too, il m’invite chez lui. Too vit dans une petite masure en bois de trois pièces avec ses deux grands chiens qu’il a appelé ironiquement Vladimir Putin et Kim jong un. Il cultive des arbres fruitiers sur environ trois hectares. Ses trois cultures principales sont le palmier à huile, le durian, connu comme le fruit qui sent le plus mauvais au monde et le mangoustan, fruit très apprécié en Thaïlande. Il ne récolte pas lui-même ces durians, mais fait appel à des récolteurs. Une compétition acharnée entre les récolteurs chinois et les thaïlandais profite aux propriétaires d’arbres. Too fait jouer la concurrence de 100 à 180 bath par kilo de fruit. Un durian peut peser six kilos. Il n’y a par contre pas de compétition entre Chinois et Thaïlandais pour la récolte des fruits de palmier à huile. Le roi des fruits est le durian, il est considéré comme « chaud », tandis que la reine des fruits, le mangoustan, est considérée comme « froide ». L’arbre du durian est difficile à cultiver, car il est sensible au manque et à l’excès d’eau. Originaire du climat équatorial qui bénéficie de pluie égale tout au long de l’année, il supporte mal le climat tropical qui alterne entre saison sèche et saison des pluies.1

Lassé des plantations, je bifurque vers l’est, dont les reliefs protègent de denses forêts tropicales. Des montagnes en colonnes, recouvertes de la forêt luxuriante qui relie leurs sommets les plus proches, surgissent du réservoir de Khao sok. Des falaises immenses de calcaire reflètent la lumière du soleil. Ce paysage qui attire nombre de touristes résulte pourtant d’une catastrophe écologique : la création du réservoir d’eau a englouti 165 km² de forêt tropicale préservée, et conduit à la disparition locale de nombreuses espèces de poissons et de mammifères.2 La jungle sombre qui les recouvre cache une grande diversité biologique.3 Sur le sol noir de ces forêts, j’éprouve leur immense et obscure diversité face à la multitude verte. La pratique de la botanique, en France, demande de concentrer son regard dans le premier mètre au-dessus du sol, pendant les quelques mois du printemps, pour observer la floraison concentrée des plantes herbacées. En forêt tropicale, la posture du botaniste est tout autre. Les fleurs ne sont pas concentrées à hauteur d’yeux, mais distribuées à tous les étages. La plupart des floraisons des arbres demeurent inaccessibles, à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, tout comme les plantes épiphytes de la canopée. Le tronc et les branches principales de beaucoup d’arbres offrent heureusement leurs fleurs à portée d’yeux, parfois même au ras du sol. Un foisonnement de lianes entremêlées nous fait tourner la tête, à la recherche de leur fleur étagée, tout comme d’autres épiphytes qui poussent partout. Enfin, une flopée d’arbustes, de plantes herbacées et d’autres formes que je ne saurais classer, fleurissent généreusement par massifs. Les plus basses des fleurs sont cachées sous quelques-unes des feuilles en décomposition de la litière de la forêt. En imaginant les tropiques, je fantasmais sur des floraisons abondantes et riches en couleurs, ce qui n’est pas toujours faux, mais dans la forêt, les fleurs se font plutôt rares. Il faut dire que, quand en France, la période propice à la floraison est très restreinte par l’hiver froid et l’été sec, les climats tropicaux permettent des floraisons, une très grande partie de l’année. Il en résulte que le ou la botaniste herborisant en Europe a une posture plutôt prostrée et statique. Le botaniste herborisant sous les tropiques, à l’inverse, a le tournis à force de chercher la fleur partout autour de lui ou elle, et marche beaucoup pour couvrir la distance qui sépare deux fleurs en forêt.

Après une semaine à arpenter les forêts, il me faut reprendre la direction du sud. Juste à la lisière entre les forêts et la plaine agricole, je rencontre un commerçant bien joyeux qui m’invite chez lui. Alors que je m’attendais à suivre sa moto, le voilà qui démarre une grosse voiture qui ronfle ! Cette voiture est un cadeau du quarantenaire luxembourgeois, qui s’est marié avec sa sœur. Particulièrement catholique, cet homme a entraîné la conversation de mon hôte et de sa sœur vers sa religion. La famille de mon hôte est restée plus traditionnelle, elle cultive les plantes les plus rentables dans un verger diversifié. L’arbre du durian, le mangoustan, le caféier et aussi le cannabis croissent ensemble.4 Les grands-parents et les petits enfants m’accueillent avec beaucoup d’amour. Un de mes plaisirs, le soir, est de me doucher dehors, au seau, parmi les grenouilles qui nagent et coassent dans le baquet auquel je puise l’eau.

La mer n’est plus très loin. À l’approche de la côte, beaucoup de taxis remplis de touristes blancs-becs, et rouges coup de soleil me doublent en trombe. Les hôtels s’alignent sur la côte sinistrée, il y a tout juste 20 ans, par une vague meurtrière. Au bord de l’océan, l’obscurité de la nuit vient tout apaiser. J’entends le ressac calme des petits vagues de la mer d’Adaman. De gros bernard-l’hermite font raisonner leurs coquillages, qu’ils traînent sur les rochers. Au moulin à huile, les employé·ère·s finissent leur journée autour d’un tas de fruits, une bière à la main. La seule femme de l’équipe, Uraiwan, s’avance vers moi, habillée d’un t-shirt gris et d’un treillis kaki. Son visage tanné esquisse un léger sourire, elle m’invite à passer la nuit chez elle. Sur la route de sa maison, nous nous arrêtons à un magasin 7-eleven pour acheter les ingrédients du repas de ce soir. Cette supérette multiservice américaine est typique de l’Asie : on y trouve un peu de tout, mais surtout de petits sachets en plastique de gâteaux et des petites bouteilles de boissons sucrées. Pendant qu’ Uraiwan fait les courses, sur le parking, les chauffeurs de pick-up, pour la plupart chargé de fruits de palmier, sollicitent l’expertise de son mari pour évaluer la valeur de leur récolte. Le lendemain, ils retournent au travail, pas de week-end en période de récolte. Des lambeaux de forêt karstique semblent volers au-dessus d’une mer de palmiers à huile, perchées comme elles sont sur leurs collines verticales de calcaire. Cette perspective se retrouve régulièrement tout le long de la côte du sud, de Phuket à la Malaisie.5 Tendu vers ma prochaine ligne d’arrivée, la frontière malaisienne, je ne prends pas le temps de visiter les îles du large, et choisis la toute proche de Koh Lanta pour une brève expérience insulaire. Après les pluies diluviennes, des chants comiques, presque grotesques, sortent des buissons luisants. Je pense d’abord à des vaches d’un genre inconnu, qui se répondraient en écho par de brefs meuglements, à moins que ce ne soit des gamins qui s’amusent avec des boites à meuh ? Les responsables de ces chants se révèlent dans un fossé inondé. Des petites boules bien rondes se gonflent avant de faire résonner leur meuglement tonitruant. À défaut de se faire grosses comme des beaufs, ces grenouilles chantent aussi fort. Ce sont ces mêmes batraciens du genre Kaloula qui se font écraser par les voitures trop nombreuses de l’île.

Quelques heures après le passage de la frontière malaisienne, les orages se forment et bientôt tonnent. La pluie qui promet de tomber m’incite à trouver un toit pour la nuit. C’est au bout d’une petite route qui va vers un lac, que j’espère trouver mon abri champêtre. Au lieu de découvrir une belle étendue d’eau, une digue doublée de barbelé barre la route. Des voies d’hommes proviennent d’un grand hangar encombré de casier rouillé, et de poutres d’acier déformées. Je fais connaissance avec un groupe de six travailleurs bangladais, qui habitent la partie aménagée du hangar. Le plus âgé des six Bahbool parle anglais, il me raconte sa vie de travailleur expatrié. Il travaille depuis ses 13 ans. Il a parcouru une bonne partie de l’Asie du Sud-Est au cours de sa vie. Il a notamment travaillé dans une usine de fabrication d’ordinateurs à Singapour, pendant huit ans avec un bon salaire régulièrement payé. Depuis trois ans, il travaille avec ses camarades en Malaisie. Ils logent dans ce hangar à deux par chambre, pour travailler dans l’usine de ciment toute proche. Aucun salaire ne leur a été versé depuis les deux mois qu’ils travaillent ici. Ils ont donc décidé tous ensemble, qu’ils n’iraient plus travailler tant que leur dû ne leur serait pas donné. La maigre part de la valeur qu’ils exigent s’élève à soixante-dix Ringgits, soit quatorze € pour huit heures de travail par jour, quand, dans le même temps, ils ne gagneraient que cinq € au Bangladesh. La vie de ces hommes se passe le plus souvent loin de leur famille, qu’ils visitent une fois ou deux par décennie. Leur espoir est de pouvoir payer l’université à leur enfant, et une retraite à leurs parents.6 À quelques kilomètres de là, sur la côte, un petit port de pêche m’offre un refuge pour échapper à l’orage. J’y reste finalement cinq jours, parmi les pêcheurs qui passent devant l’abri que Rohizan le gardien, m’a indiqué. Le poisson manque en ce moment, seul le pêcheur de crevette longe la côte tous les matins. Pour passer du bon temps le soir, les amis de Rohizan se retrouvent autour d’une bouteille, d’un liquide violet. Je comprends que c’est une boisson interdite, quant à mes questions, ils me répondent par des rires. La couleur violette du liquide résulte du mélange de cola avec le jus épais de « Daun ketum », les feuilles de Mitragyna speciosa, un arbre de la famille du café. Les buveurs les plus assidus ont les yeux injectés de sang, et m’avouent ne pas pouvoir s’en passer. La consommation de cette plante est aujourd’hui criminalisée en Malaisie. Pourtant, ces effets sont moins nocifs sur la santé que ceux du tabac, par exemple. Comme pour beaucoup d’autres végétaux, le gouvernement malaisien a même tenté un temps, l’industrialisation de la culture de cet arbre.7 Le long de la côte marécageuse, les pêcheurs essayent de reconstituer la mangrove en plantant des arbres qui formeront la pouponnière de leur future prise.8 Les champs de riz occupent tout l’espace entre les collines et la mer. Sur une petite route droite, je roule au milieu des parcelles inondées, vers des villages qui sont comme des îles sur un immense lac hérissé d’herbes.

Des immeubles gris sans fenêtres jalonnent ce chemin, ce sont d’immenses abris à Marinette. Ces oiseaux y fabriquent leurs nids avec un mucus mucilagineux, qu’ils excrètent par leur bec. Véritable industrie en Malaisie, 60.000 fermes de ce genre étaient implantées sur la péninsule en 2017. La quasi-totalité de ces nids est exportée vers la Chine, pour donner de la texture et des vertues médicinales aux soupes.9 D’autres immeubles interrompent les rizières, des grues barrent l’horizon de l’océan, j’arrive à Penang la deuxième ville de Malaisie. Au centre-ville historique de Georges town, les temples bouddhistes, indous, musulmans et chrétiens se côtoient dans un même quartier. Ce résultat cosmopolite est hérité de l’occupation britannique, dernier empire à avoir envahi la ville après les Hollandais et les Portugais. Pour exploiter ces ressources naturelles, les colons avaient besoin de main-d’œuvre introuvable localement, car les sultanats, souverains sur leur population, n’acceptaient pas qu’elle travaille pour les Européens. Les négociants britanniques ont donc recours à l’immigration de main-d’œuvre, venue de Chine pour les mines d’étain puis d’Inde pour les palmeraies. Pendant mon séjour sur l’île de Penang, les Malais chinois, bien établis dans les villes, fêtent en grande pompe le « wesak day », le jour de Bouddha. Quelques jours plus tard, sur une route principale, je me retrouve par hasard face à un rassemblement Indous, le Thaipusam qui est la célébration des dieux de la guerre. Au milieu des fanfares traditionnelles, de jeunes hommes portent un d’habits de boules argentées accrochées une à une, avec un crochet fiché dans leur peau. Ces apparts ainsi que d’autres structures immenses portées sur leurs épaules sont considérés comme des temples nommés « Kavadi ». Pour compléter le costume, ils et elles se persent la langue ou les joues de part en part avec des piques en forme de flèches. Les dévots pensent que la souffrance qu’ils et elles s’infligent montrera leur dignité aux dieux et portera chance à leur famille.10
Entre les immenses immeubles d’habitation, de petits bidonvilles survivent. Dans l’un d’eux, la cabane abandonnée des pêcheurs m’abrite tout mon séjour, avec l’assentiment des pêcheurs thaïlandais amusés de leur nouveau voisinage. Si la cabane protège bien mon hamac de la pluie qui vient du ciel, elle est impuissante face aux vagues énergiques de la marée haute, qui mouillent le bas de la terrasse. Les pêcheurs, eux, sont déjà partis sur la mer d’espérance de leur terre d’accueil.11
Chant des étrange des Grenouilles taureau de Malaisie
La carte du chemin accompli :
Liens :
- https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2024/05/04/heatwave-hammers-thailand039s-stinky-but-lucrative-durian-farms ↩︎
- Sacha Duroy, « Lac Cheow Larn : le joyaux de Khao Sok », Gavroche Thaïlande, no 233, mars 2014, p. 36 à 38 ↩︎
- https://asean.chm-cbd.net/khao-sok-national-park ↩︎
- https://www.courrierinternational.com/article/reportage-en-thailande-planter-du-cannabis-n-est-plus-une-aubaine ↩︎
- ↩︎
- https://www.monde-diplomatique.fr/2021/02/BENGTSEN/62772 ↩︎
- https://newsroom.iium.edu.my/index.php/2023/04/24/kaca-mataku-ketum-complicates-already-complex-health-versus-economics-theatrics/ ↩︎
- https://foe-malaysia.org/articles/all-parties-must-commit-to-protect-and-conserve-mangrove-forests/
https://www.foei.org/fr/pecheurs-deboisement-mangroves-malaisie/ ↩︎ - https://undisciplinedenvironments.org/2014/10/28/landscape-politics-of-swiftlet-farming-in-george-town-malaysia/ ↩︎
- https://www.france24.com/en/live-news/20230205-piercings-and-prayer-malaysian-hindus-celebrate-thaipusam ↩︎
- https://www.aspirepenang.org/our-stories ↩︎
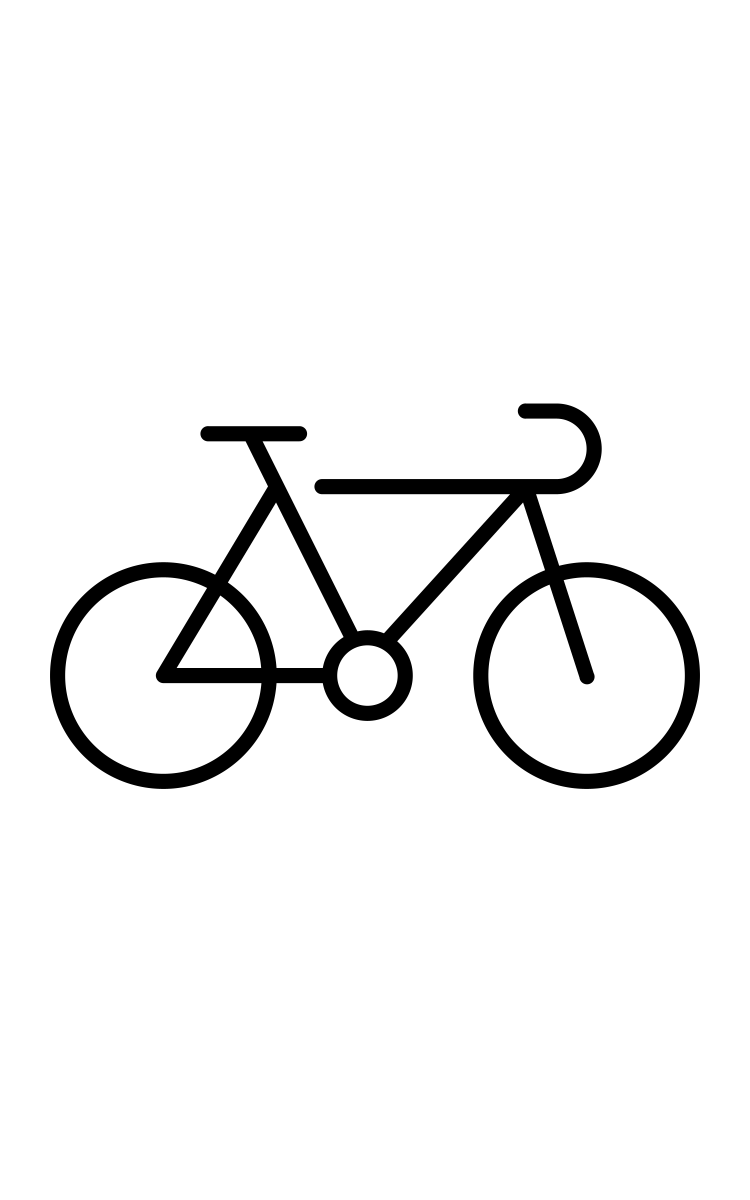

Laisser un commentaire