En Malaisie et en Indonésie
Une dernière gorgée d’eau tarie la vieille bouteille en plastique à usage unique qui me sert depuis quelques semaines. De l’autre côté de la route, une jeune femme d’origine indienne m’interpelle. Elle a repéré les bouteilles d’eau asséchées sanglées sur mes bagages. Avec ses parents, elle récolte le latex de quelques hévéas isolés en bord de route. D’un ton impératif, elle m’ordonne de lui livrer les contenants vides pour compléter leur installation SOURCE 1. Puis abruptement, elle me conte avec dédain l’histoire de son mariage avec un jeune homme, qui l’a rapidement quitté pour une autre femme moins pauvre d’argent. En laissant ce trio qui bricole pour survivre, j’ai bizarrement le cœur léger. Les sentiments que j’éprouve face aux rencontres de tous les jours, ont changé depuis le stage de méditation achevé une semaine plus tôt. Auparavant, l’empathie que je ressentais devant la misère du monde me pesait de plus en plus. Les questions toujours identiques que les passants me posaient sur mon identité, ma destination m’exaspérait et leur condition matérielle, que je jugeais peu enviable finirent par me donner un vague à l’âme, que j’essayais tristement de fuir. Depuis une semaine, j’ajoute plus souvent de l’amour à l’empathie ou au rejet, que j’éprouve pour la transformer en compassion. Ce sentiment est beaucoup plus facile à vivre 1, la douleur de la pure empathie, c’est doublé d’un amour pour toutes celles et ceux que je rencontre. Là où j’avais fini par jeter un regard épuisé et impuissant, j’aime et donne plus facilement à présent.

Dans la ville de Malacca plusieurs camarades de route me retrouvent par hasard. Arrivent d’abord Vera et Stan, un couple parti du lac Baïkal il y a un an, puis l’ami Didier que j’avais quitté en Inde. Ensemble, nous prenons le ferry pour traverser le détroit de Malacca en direction de l’intrigante île de Sumatra. Ce bras de mer stratégique pour le commerce international fait frontière entre les États-nations post coloniaux de Malaisie et d’Indonésie. Avant de constituer une frontière, le détroit de Malacca reste une mer intérieure pour ses populations riveraines 2. À la sortie du port, nous nous rendons immédiatement compte du fossé économique qui sépare la Malaisie de l’Indonésie. L’odeur de plastique carbonisé des tas de déchets en combustion a un parfum d’Inde. La densité et l’archaïsme du trafic nous plongent immédiatement dans le bouillonnement des villes indonésiennes. Nous trouvons heureusement des petites routes défoncées pour rouler plus au calme. Nous nous enfonçons progressivement dans l’infini des plantations de palmier à huile. Cette culture couvre la quasi-totalité de la plaine Est de Sumatra. La province de Riau que nous traversons a concentré 42 % de la forêt abattue à Sumatra entre 1990 et 2010 3 A de rares endroits, quelques lambeaux de forêt marécageuse résistent çà et là quand ils n’ont pas été rasés ou remplacés par des végétations secondaires dominées par des graminées. Dans les terrains les plus humides, les implantations de palmiers sont cultivées sur buttes séparées de petits canaux. Le long des pistes poussiéreuses, de petits villages en bois sont établis. Des enfants nus courent ensemble devant les maisons. Des familles entières s’affairent à éplucher puis à hacher à la machette les énormes fruits du palmier. Nous partageons la route avec les camions chargés de fruits et les habitants en deux roues. Quelques fois des gardiens de plantations nous barrent la route, ils travaillent pour la compagnie de pétrole nationale Pertamina détentrice de nombreuses plantations dans la région L’huile de ces plantations sert à fabriquer le diesel bon marché, que l’on trouve revendu partout au bord des routes vendu comme l’eau en bouteille plastique. Les propriétés des plantations sont bien délimitées, nous nous heurtons à une véritable muraille de terre doublée d’un fossé qui court sur plusieurs dizaines de kilomètres. La gentillesse des habitants nous sauve une fois de plus, puisqu’ils nous guident pour retrouver notre chemin. La spontanée générosité des Indonésiens est malheureusement bridée par les règles des grands propriétaires terriens et de l’infernale bureaucratie nationale. Quand nous demandons un petit coin pour planter nos tentes, une chaîne de commandement se met en branle. Le premier habitant rencontré nous dit qu’il doit demander la permission au RT pour « Rukun Tetangga », qui est le chef de quartier. Après nous avoir examiné, le RT appelle souvent le RW pour « Rukun Warga » qui est le maire du village. Nous pourrions penser que l’autorisation du maire suffise, mais cela reste souvent insuffisant. C’est le propriétaire de la plantation, dans lequel est inclus le village, qui, joint par téléphone prend la décision finale4. Obtenir l’autorisation de camper parmi les palmiers devient alors quasiment impossible. C’est au bout d’une chaine comme celle-ci que Madan, un des gardiens à l’entrée des plantations, nous invite chez lui. Sa famille nous réserve un accueil chaleureux. Nous faisons connaissance avec ses deux filles, dont l’aînée est mère d’un petit qui marche entre les plats de légumes, de riz et de piments que Tresni, la femme de Madan nous sert. L’intérieur de la maison est simple comme toujours, l’unique meuble de la chambre/salle à manger est une étagère pleine de trophées et de peluches qui entoure la télévision et des enceintes pour le karaoké.

Le lendemain, nous grimpons notre première montagne de l’île de Sumatra. Comme souvent, nous empruntons l’unique route asphaltée qui concentre tout le tragique trafic routier, sur les pentes abruptes de la montagne. L’atmosphère se rafraîchit, mais l’air n’y est pas plus pur.
Lorsque la pente de la route change de déclivité, les camions qui passent une vitesse nous envoient des nuages compacts de fumée noire, que nous finissons au bout de notre apnée, par
inspirer. Un peu en dessous du col, nous cherchons un campement pour la nuit. Comme à leur habitude, les villageois appellent le maire pour nous guider. Armon, le maire du village, nous
invite chez lui, il habite au bord de cette route passante. À la nuit tombée, les écoliers se réunissent sous ses fenêtres pour jouer de la guitare et fumer ensemble. Armon fut ingénieur d’usine pour une multinationale. À la fin de sa carrière, il soutenait les luttes syndicales des
employés. Il nous révèle que certaines années, des habitants partis travailler en Malaisie pour de meilleurs salaires reviennent aliénés, désorientés. Selon lui, la police malaisienne punirait les travailleurs indonésiens illégaux par des injections d’un produit, qui altère leur psychisme pour une durée d’un an environ. À l’aube, le maire nous emmène à la rencontre des Siamangs, ces singes chanteurs des montagnes de Sumatra et de Malaisie. Une femme se met à imiter leurs cris pour les appeler. Un mouvement au loin dans la canopée annonce leur approche. Un sentiment d’allégresse monte en nous à la vue de ces animaux au long bras, qui se balancent de branche en branche. Les primates chanteurs arrivent finalement à notre rencontre, attirés par les brioches que nous leurs tendons. Les provisions épuisées, ils et elles n’hésitent pas à fouiller dans nos poches à la recherche de plus de pâtisserie. Nous les laissons retourner à leur repas de feuille habituel dans les figuiers bagnans. Tout juste après avoir quitté la roche, les voilà qui commencent à lancer des vocalises amplifiés par une poche située au niveau de leur gorge. J’écoute leur exclamation mélodieuses avec émotion, en espérant que les humains leur laisseront assez d’espace pour vivre. Cette espèce de singe est aujourd’hui considérée comme en danger par le classement UICN. La déforestation de leur habitat est la principale menace qui pèse sur eux5.
Charmés par les montagnes verdoyantes et leur habitant, nous restons une semaine au frais dans les montagnes, pour aider Armon à planter des piments sur son bout de terre dans la forêt. ARTICLE : Des piments chauds dans des montagnes tempérées… Nous continuons notre route en suivant la chaîne de montagnes des Barisan vers le sud-est. La route est difficile, mais superbe. Environ cinq montagnes nous séparent de notre objectif, le mont Kerinci, plus haut volcan d’Indonésie. Le premier jour, nous descendons sous les 1000 mètres dans la chaleur et le tumulte d’une petite ville. Le deuxième jour, nous grimpons les pentes abruptes d’un volcan au sommet où repose, un grand et paisible lac d’altitude. Le troisième jour, nous descendons à travers des montagnes cultivées où le jeune feuillage rosé des arbres à cannelle est gourmand. En fin d’après-midi, nous entrons dans une vallée étroite. Une sorte de lumière automnale sous les tropiques, nous emplie d’une douce nostalgie. Les jeunes feuillages sont d’un beau rose, enflammé par des raies de lumière qui filtrent à travers l’atmosphère bleutée. Ému, nous nous laissons glisser vers le bas de la vallée qui s’ouvre.

Nous pensions trouver facilement un campement au bord de la rivière. C’était sans compter l’économie de la vallée basé sur l’extraction de l’or. Des dizaines de petites installations purifient le minerai aurifère au bord de la rivière. Dans leurs petites fabriques, les chercheurs d’or broient, décantent et brûlent le minerai à la recherche du métal précieux. Après trois tentatives ratées pour trouver un campement calme loin de ces fabriques bruyantes, nous pensons trouver un endroit calme près d’une mosquée. L’imam nous indique une baraque en bois collée au sanctuaire. En se rapprochant de la baraque indiquée, Didier râle, un moteur tourne, pour ici aussi, purifier l’or… Harassés de fatigue, nous nous résignons à dormir ici. L’équipe d’orpailleur nous explique joyeusement le procédé. Dans notre lieu de repos, seules les étapes finales de l’extraction sont présentes. Les étapes les plus bruyantes qui consistent à réduire en poudre le minerai puis à le rouler avec du mercure, sont faites chez un des cinq associés qui traitent le minerai extrait par 10 mineurs de fonds. Nous passerons la nuit juste à côté de la marmite d’arsenic bouillante. Nos hôtes nous réveillent tôt le lendemain matin pour vider la marmite. Son contenu est filtré et tout le mélange toxique se déverse dans la rivière voisine. La dernière étape d’extraction de l’or consiste à faire brûler pendant 16 heures le sable obtenu jusqu’à l’obtention des paillettes d’or. Nos hôtes sont fiers de nous montrer les paillettes d’or obtenues. Avec le résultat de leurs ventes, ils peuvent espérer gagner jusqu’à 800€ par personne tous les mois, un montant quatre fois supérieur au revenu médian espéré pour la région. Pour ce prix, les hommes sont prêts à prendre des risques énormes. La veille, nous avons rencontré un mineur de fond. Ils extraient le minerai dans leur mine dont le puits le plus profond descend à 50 m, et la galerie la plus longue court sur plus de 100 m. Ils nous assurent que leur mine est sûre, et qu’il y a peu d’accidents mortels dans la région. Pourtant, quelques jours après notre départ, nous apprenons qu’un glissement de terrain a causé la mort de 12 mineurs dans la région6.

Nous quittons ces hommes et la boue toxique de leur fabrique pour chercher l’air pur. Une série de trois montagnes nous séparent encore du mont Kerinci. En haut de la dernière côte, après trois jours de souffrance et de paysages époustouflants, nous arrivons à la base du volcan. En contrebas de la route, une cascade puissante vomit en continu un torrent d’eau. Un gigantesque champ de thé vert clair en forme de demi-lune borde un côté du cône volcanique couvert d’une forêt équatoriale vert sombre. Tout en haut, le sommet rouge se perd dans les nuages. Avant l’aube, nous commençons à marcher sur le sentier qui s’enfonce tout droit dans la forêt des flancs du volcan. Les fougères Asplenium nidus sont vigoureuses, elles se développent en d’imposants bouquets chlorophylliens évasés. Plus loin, la forêt des nuages offre une grande diversité de fougère, de mousse et de lichens qui attendent leur bain de brume. Le dernier tiers du sentier devient plus sportif, nous marchons dans des tranchées boueuses et sur des pentes glissantes. Heureusement, les racines par lesquelles la végétation se cramponne nous servent de prise. En milieu de journée, nous atteignons le dernier campement. Les arbres ont disparu, seuls des buissons compacts se développent sur la roche volcanique. Les floraisons sont colorées, les fleurs rouges ou rose des Éricacées tranchent sur les inflorescences noires aux étamines jaune orangé des carex. Entre ces beautés végétales, le plastique en masse compacte partiellement carbonisé s’accumule. Quelques heures plus tard, les groupes de jeunes touristes du pays, que nous avions dépassé nous rejoignent. Tout le monde est au rendez-vous pour s’émerveiller face au soleil qui se couche.
Appelle à la prière qui monte des villages jusqu’en haut du volcan
SOURCES
- https://www.unige.ch/lejournal/numeros/93/article1/article1bis/#:~:text=En%20quoi%20cette%20distinction%20est,aider%20la%20personne%20qui%20souffre. ↩︎
- https://www.persee.fr/doc/asean_0859-9009_2009_num_23_1_2087 ↩︎
- https://news.mongabay.com/2012/08/rainforests-decline-sharply-in-sumatra-but-rate-of-deforestation-slows/amp/ ↩︎
- https://www.academia.edu/87601653/Oil_Palm_Governance_at_the_Grassroots_How_Assemblage_Links_Oil_Palm_Livelihoods_and_Local_Administration_in_an_Indonesian_Village?source=swp_share ↩︎
- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Siamang ↩︎
- https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/09/27/15-dead-dozens-missing-after-landslide-at-illegal-west-sumatra-mine.html ↩︎
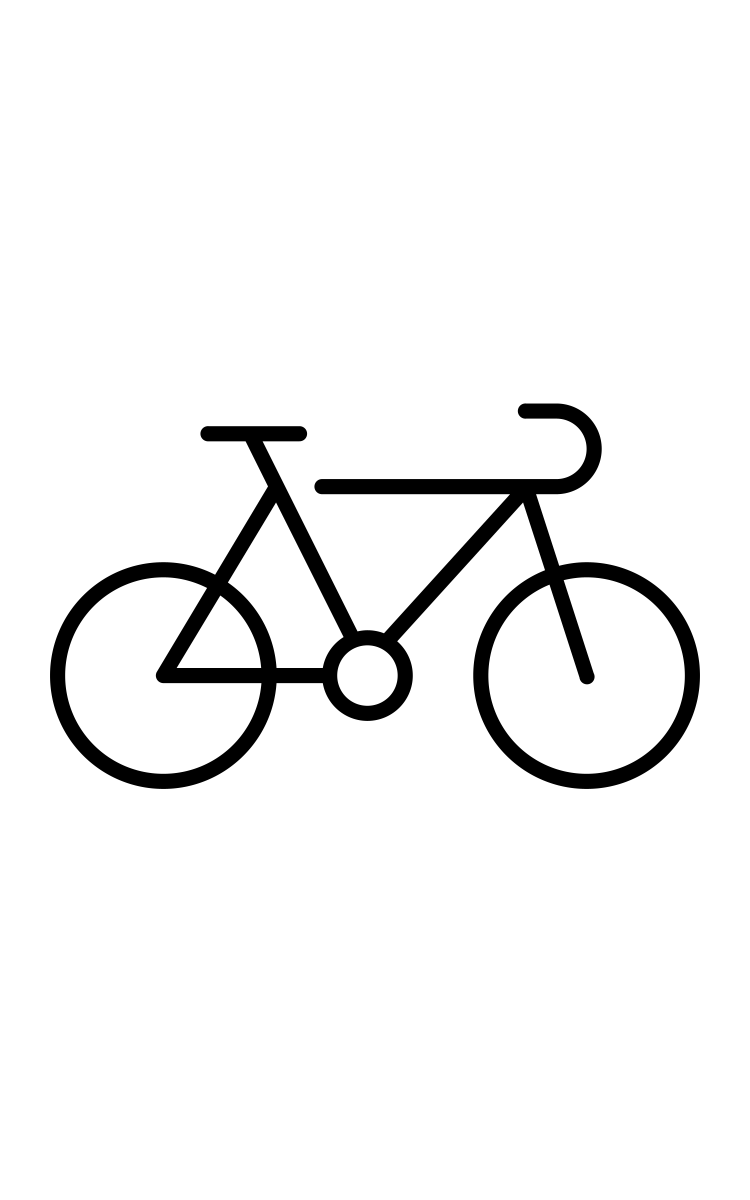

Laisser un commentaire